Thème : Cartographie et surveillance des mangroves : enjeux, innovations et défis pour une conservation participative et inclusive
Le dialogue sur les écosystèmes de mangroves s’est poursuivi au deuxième jour du colloque par l’exploration de la thématique de « la découverte des données classiques et des nouveaux outils et technologies d’analyses géospatiales ». La thématique de la photographie et la narration visuelle en tant qu’outils de plaidoyer pour les femmes a également été abordée.
En ce qui concerne l’usage des données, il est ressorti que la télédétection, bien qu’ancienne, évolue sans cesse pour répondre aux enjeux écologiques actuels, en particulier pour la gestion et la restauration des mangroves. Grâce à la diversité des capteurs et des plateformes, elle permet des analyses multi-échelles et une caractérisation fine des écosystèmes, dépassant les limites des produits conventionnels. L’évaluation multicritères devient un outil stratégique, en identifiant non seulement les zones de présence mais aussi les zones potentielles de restauration écologique. Enfin, l’essor du big data démocratise l’accès aux données, offrant aux acteurs de la conservation une base solide pour des décisions informées et durables.

Les délibérations de la deuxième présentation ont souligné que la technologie satellitaire et géospatiale joue un rôle déterminant dans la surveillance des mangroves à grande échelle, offrant des données actualisées et des alertes quasi instantanées qui facilitent les décisions de conservation et de restauration. La plateforme interactive du Global mangrove Watch a été présenté comme un outil gratuit d’analyse de l’évolution des mangroves avec la possibilité de générer des alertes sur leur dégradation. Son accessibilité renforce l’inclusion des acteurs variés — scientifiques, ONG, communautés — et soutient une gestion partagée des territoires côtiers. En fournissant des indicateurs clés sur le carbone et les services écosystémiques, elle contribue activement à la lutte contre le changement climatique. Grâce à la visualisation dynamique des données, cette approche devient un véritable outil de prise de décisions, stratégique et mobilisateur pour renforcer la résilience écologique.

Le deuxième jour du colloque a aussi exploré l’utilisation des drones et des technologies géospatiales qui sont en train de transformer profondément la restauration des mangroves, en rendant les interventions plus précises, rapides et moins coûteuses que les méthodes traditionnelles. Grâce à l’imagerie multispectrale et au suivi par télédétection, les opérations de plantation et d’évaluation post-restauration gagnent en efficacité. L’intégration de paramètres écologiques et de données dans les outils d’aide à la décision permet une planification stratégique et adaptée aux contextes locaux. Le drone est aussi un outil pour la dissuasion contre la coupe de bois. Ainsi, l’innovation devient un levier majeur pour renforcer la résilience des écosystèmes côtiers de manière durable et inclusive.
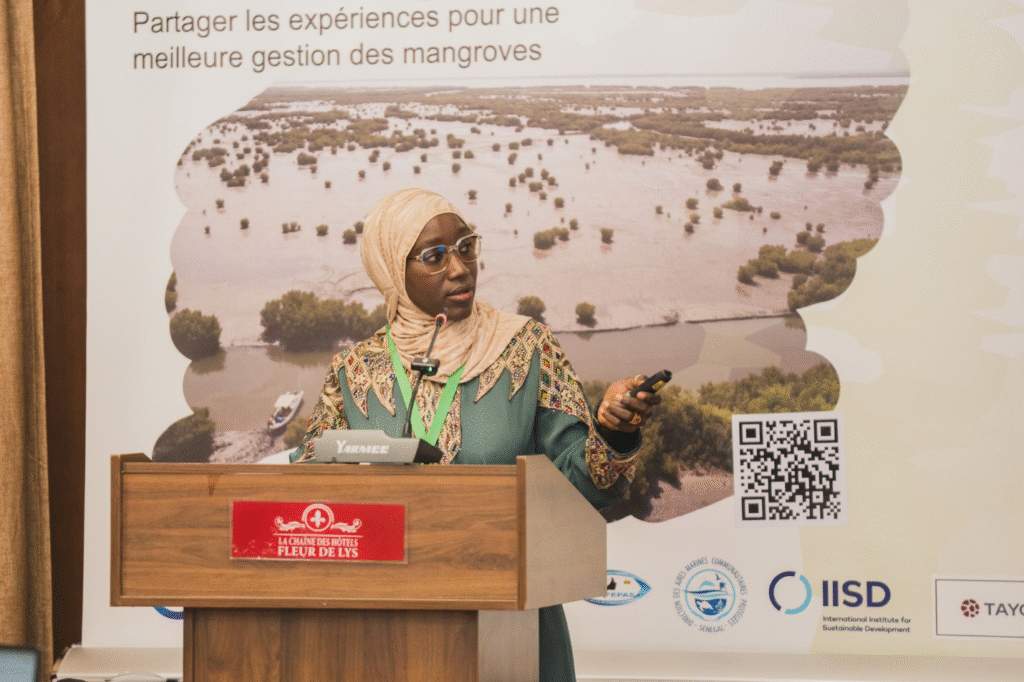
Il a aussi été question d’explorer les « Dynamique spatio-temporelle de l’AMP du Kalone Bliss Kassa en Casamance ». Au Sénégal, la conservation des mangroves repose sur la mise en place d’Aires Marines Communautaires Protégées, véritables leviers de préservation écologique, structurées autour d’une planification en deux phases : diagnostic et plan co-construit. Ici, on note que l’engagement des communautés locales s’avère essentiel pour garantir l’efficacité et la durabilité des stratégies de restauration, qui doivent être progressives et contextualisées. La valorisation des biens et services des mangroves apporte des retombées concrètes aux populations riveraines et renforce le lien entre écologie et développement local. Enfin, une gestion durable des mangroves contribue pleinement à améliorer les conditions de vie tout en favorisant la résilience des territoires côtiers.
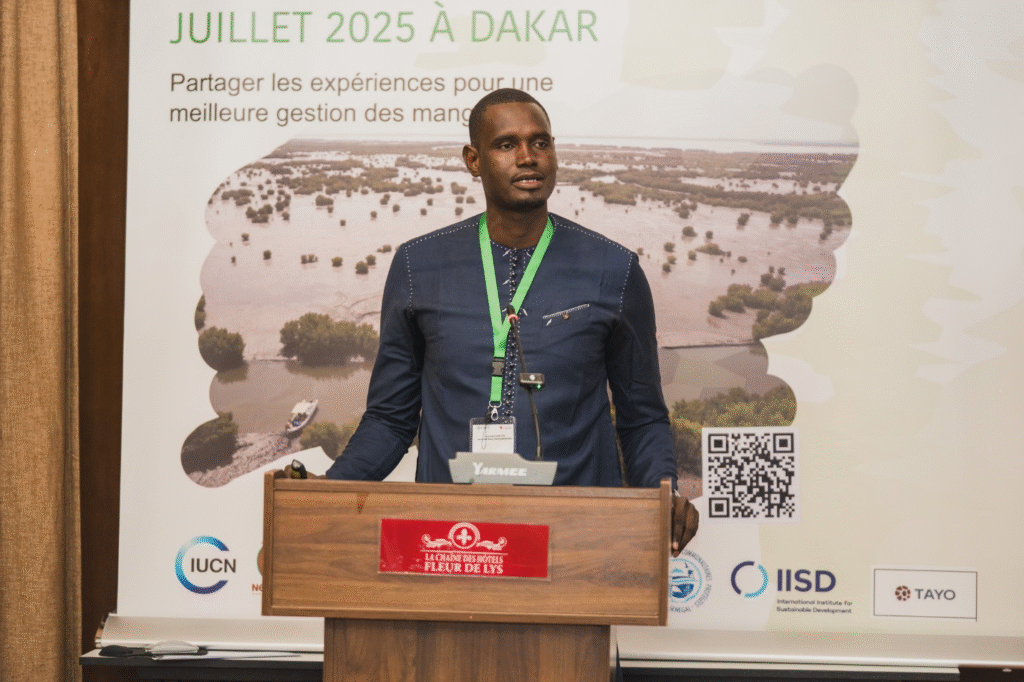
La cartographie participative a aussi été exploré comme un levier stratégique pour la gestion durable des mangroves qui renforce la gouvernance partagée grâce à l’implication directe des acteurs locaux et institutionnels. Elle facilite l’appropriation des enjeux environnementaux tout en améliorant la qualité et la pertinence des données spatiales utilisées pour la planification et le suivi. Toutefois, cette approche pose des défis techniques, sociaux et méthodologiques qu’il convient d’anticiper pour garantir son efficacité. Enfin, l’échange d’expériences au sein des panels permet d’identifier les conditions favorables à sa pérennité et à son impact sur la conservation.

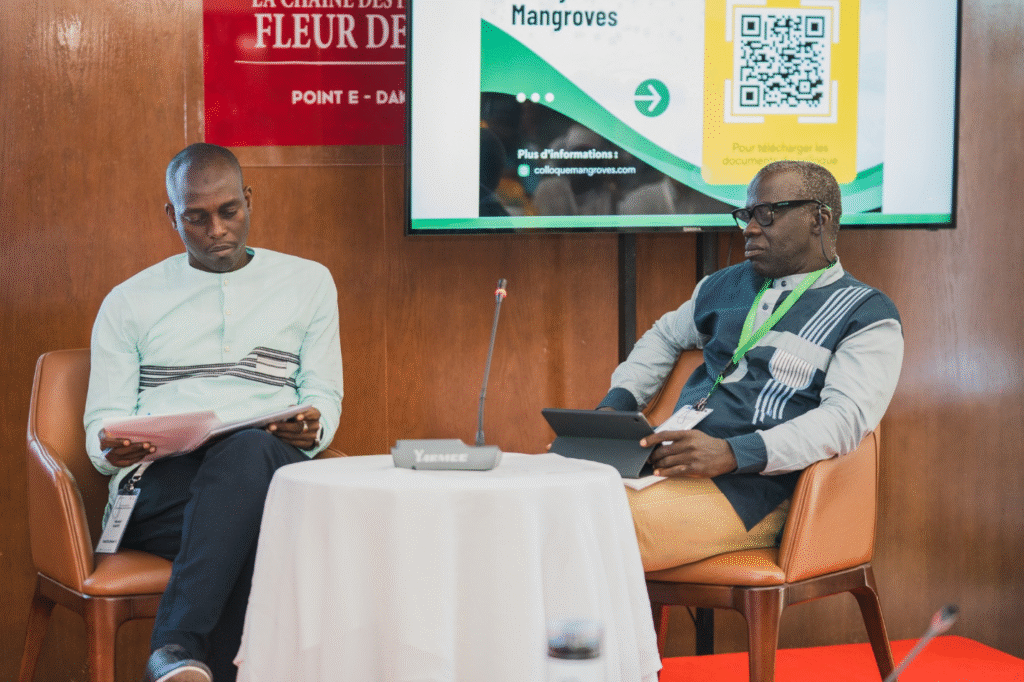
Un autre outil prometteur exploré est la méthodologie de cartographie des mangroves (GEM) qui apporte une réponse stratégique au déficit de cartographie des petites zones de mangroves, en offrant un outil libre, simple d’utilisation et adapté aux acteurs locaux. Son recours au cloud et à l’imagerie multispectrale permet des analyses rapides et précises, facilitant le suivi de l’évolution des écosystèmes. La version mobile lancée en 2025 améliore l’utilisation sur le terrain, tout en renforçant la participation communautaire à la conservation. Enfin, les formations autour de GEM assurent une meilleure interprétation des données et favorisent leur intégration dans les plans d’action écologiques.

La journée s’est terminée sur une note forte et inspirante avec une session intitulée : « Récit photographique et voix des femmes leaders à l’intersection de l’environnement, du climat et de la justice sociale ».
Dans le cadre du programme de leadership féminin, l’Institut International du Développement Durable a dispensé une formation en photographie et en narration visuelle à des femmes du Sine-Saloum et de la Casamance, afin qu’elles puissent raconter leurs histoires à travers l’image et plaider pour une plus grande inclusion dans les espaces de décision et la gestion des ressources naturelles.
Grâce à cet outil de plaidoyer, quatre femmes ont été choisies pour partager des récits inspirants sur les actions qu’elles mènent au sein de leurs communautés pour lutter contre les effets du changement





Leave A Comment