Les savoirs traditionnels suscitent un intérêt croissant en raison de leur lien étroit avec la conservation des écosystèmes et des communautés locales. Longtemps négligées, ces connaissances sont désormais reconnues comme essentielles à la gestion durable de la biodiversité. Cette étude vise à documenter les connaissances endogènes et les expressions culturelles sacrées associés à la conservation des mangroves dans les deltas du Sine-Saloum et de la Casamance afin de les intégrer dans les plans d'aménagement et de gestion des Aires Marines Protégées et Aires du Patrimoine Autochtone Communautaire.
La méthodologie s'appuie sur la socio-anthropologie de l'environnement associée à la théorie sur le genre. Une enquête qualitative a été menée auprès 338 personnes à travers 22 entretiens semi-directs et 30 focus groups. Les résultats montrent que les connaissances endogènes répertoriées sont liées aux cultes du sacré autour des bolongs et vasières, avec un système de zonation des formes d'exploitation. Les exemples incluent les bolongs sacrés de Nkololah, Kiling Kiling et Keuwéuy, ainsi que des totems protégeant intégralement des espèces telles que le lamantin et l'hyène.
D'autres pratiques consistent à la mise en défens des espaces par des fétiches à l'image du Khitong/Hitong/Houbene chez les Diolas et le Kankourang chez les Mandingues, accompagnées de sanctions en cas de non-respect. À ces pratiques, s'ajoute l'utilisation d'outils traditionnels durables tels que le panier de Moundé pour une récolte raisonnée des arches (Anadara senilis). Cette étude met en évidence des stratégies de gestion essentielles dans le plaidoyer pour l'intégration des savoirs traditionnels dans les politiques de gestion environnementale au Sénégal.

Biologiste de formation, Mme Ndour est titulaire d'un doctorat en connaissances, conservation et valorisation de la biodiversité à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Avant de rejoindre le Bureau régional de l'UICN_PACO en tant que Spécialiste Biodiversité du Projet Natur'ELLES, Dr NDOUR a occupé le poste d'Associée de projet en charge du Suivi, Évaluation et Apprentissage à Wetlands International Afrique.
Elle a également occupé d'autres fonctions au sein de la même organisation notamment comme consultante chercheuse du Projet survie des tortues marines en Afrique de l'Ouest. Dans ses différentes positions, elle a conduit la mise en œuvre de projets en lien avec la conservation des écosystèmes marins et côtiers dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Elle apporte une solide expérience dans le domaine de la gestion des zones humides et la résilience des communautés locales dépendantes de la biodiversité.
Les savoirs traditionnels sont indispensables à la gestion des ressources naturelles et s'avèrent incontournables pour asseoir une gouvernance inclusive et participative des ressources naturelles. La mise en œuvre de solutions fondées sur la nature offre un cadre unique pour intégrer les savoirs traditionnels et locaux dans la gestion et la gouvernance des ressources naturelles.
Dans ce contexte, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le PRCM a entrepris de réaliser une étude pour la capitalisation et la valorisation des savoirs traditionnels et locaux en matière de conservation de la biodiversité et de gestion durable des ressources naturelles. L'étude s'inscrit dans la mise en œuvre des activités du projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable financée par le Affaires Mondiales Canada dans le cadre de l'initiative Partenariats pour le Climat.
L'objectif est de capitaliser les savoirs locaux et traditionnels liés aux Solutions fondées sur la nature (Sfn), afin de renforcer l'adaptation aux changements climatiques et d'assurer la conservation durable de la biodiversité et des ressources naturelles.
Nous échangerons autour des résultats attendus et de leur importance capitale pour la conservation et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans les écosystèmes de mangrove. Nous nous baserons également sur nos connaissances antérieures dans le cadre d'études similaires sur les savoirs endogènes.
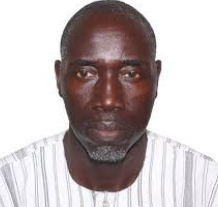
Docteur d'État et sciences naturelles de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques. Coordonnateur scientifique des projets du Cégep de la Gaspésie et des Îles en Afrique de l'Ouest.
En rapport avec les savoirs endogènes, avec son équipe, il travaille sur cette thématique depuis 2010. Il a encadré une thèse de doctorat sur le thème : « Savoirs locaux et modes traditionnels de gestion des ressources naturelles marines et côtières en Basse Casamance : perspectives de leur intégration dans le système conventionnel ». Il est co-auteur de plusieurs articles scientifiques (éthnoécologie) sur les savoirs endogènes et les sites naturels sacrés en Casamance et au Saloum.
Le projet Action Climatique Féministe en Afrique de l'Ouest (ACF-AO), est mis en œuvre par le consortium Inter Pares et SUCO au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Togo. Il vise l'adaptation aux changements climatiques des femmes rurales et des jeunes dans les communautés côtières et insulaires écologiquement sensibles à travers : (1) une influence accrue dans la gouvernance climatique locale, (2) une autonomisation économique sensible la transition énergétique, et (3) l'adoption de solutions fondées sur la nature et les communautés pour la protection et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité.
Au Sénégal, les partenaires locaux du projet, ENDA PRONAT, JVE, CNCR, APISEN et SUNTAEG contribuent à une gestion durable des écosystèmes de mangrove dans les Aires Marines Communautaires Protégées (AMCP) de la Casamance (Abéné, Kalone Bliss Nassa, Ufoyaal Kassa Bandial, Niamone Kalounayes) et dans la réserve naturelle de Palmarin. Après deux années de mise en œuvre avec les communautés, le projet ACF-AO est en mesure de partager des apprentissages qui apporteront une valeur ajoutée au colloque.
L'objectif est d'illustrer la pertinence des systèmes endogènes de conservation et des valeurs culturelles locales (portés par les femmes) dans la protection des mangroves au Sénégal.

Niang est directeur exécutif de JVE Sénégal et coordonnateur national de la plateforme Dakclim. Diplômé en énergies renouvelables, il est engagé pour le climat, la biodiversité et les emplois verts. Cofondateur de la Green Team Sénégal, il a lancé l'incubateur SEN GREEN LABS. Lauréat de plusieurs prix, il œuvre pour une transition écologique inclusive au Sénégal.
Les écosystèmes de mangroves sont des milieux riches, complexes et vitaux pour les équilibres écologiques côtiers. Au-delà de leur fonction écologique de barrière naturelle contre l'érosion et de puits de carbone, ces espaces sont aussi le théâtre de savoirs, de pratiques et de traditions transmis de génération en génération. Ces savoirs locaux, souvent portés par les femmes et les communautés autochtones ou rurales, constituent un patrimoine immatériel vivant au service de la conservation et de l'usage durable de ces écosystèmes.
En effet, la gestion traditionnelle des mangroves — à travers des pratiques telles que la collecte durable, la restauration communautaire, l'organisation des espaces de pêche ou encore les calendriers agricoles et spirituels liés aux cycles naturels — témoigne d'une connaissance fine des dynamiques écologiques et sociales. Ces savoirs, bien que souvent non formalisés, complètent et enrichissent les approches scientifiques contemporaines.
Ce panel vise à explorer comment les savoirs locaux contribuent activement à la préservation des mangroves, tout en favorisant la résilience des communautés, le leadership féminin, et la transmission intergénérationnelle des pratiques durables. Il s'agira également d'interroger les conditions nécessaires pour reconnaître, valoriser et intégrer ce patrimoine immatériel dans les politiques publiques et les projets de conservation.
En croisant les regards de chercheur-e-s, de leaders communautaires, d'organisations de femmes et de praticiens de la conservation, ce panel offrira une plateforme d'échange sur les enjeux, les limites et les perspectives de cette intelligence locale, essentielle pour bâtir des stratégies de gestion véritablement ancrées dans les territoires.

Mariama Diallo est une socio-anthropologue sénégalaise spécialisée dans les politiques de conservation, le développement local et la gouvernance. Elle est la coordinatrice des projets de l'association Nébéday, une organisation sénégalaise engagée dans la gestion participative des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Elle est également investie dans la valorisation des savoirs locaux, la co-construction de solutions fondées sur la nature et la promotion d'une gouvernance équitable des ressources naturelles.

Biologiste de formation, Mme Ndour est titulaire d'un doctorat en Connaissance, Conservation et Valorisation de la Biodiversité à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Avant de rejoindre le Bureau régional de l'UICN_PACO en tant que Spécialiste Biodiversité du Projet Natur'ELLES, Dr NDOUR a occupé le poste d'Associée de projet en charge du Suivi, Évaluation et Apprentissage à Wetlands International Afrique.
Elle a également occupé d'autres fonctions au sein de la même organisation notamment comme Consultante Chercheure du Projet Survie des Tortues Marines en Afrique de l'Ouest. Dans ses différentes positions, elle a conduit la mise en œuvre de projets en lien avec la conservation des écosystèmes marins et côtiers dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Elle apporte une solide expérience dans le domaine de la gestion des zones humides et la résilience des communautés locales dépendantes de la biodiversité.
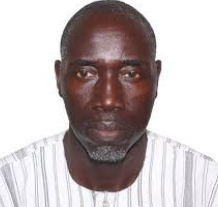
Docteur d'Etat ès Sciences naturelles de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques. Coordonnateur scientifique des projets du Cégep de la Gaspésie et des Iles en Afrique de l'Ouest.
En rapport avec les savoirs endogènes, avec mon équipe, je travaille sur cette thématique depuis 2010. J'ai encadré une thèse de doctorat sur le thème : « Savoirs locaux et modes traditionnels de gestion des ressources naturelles marines et côtières en Basse Casamance : perspectives de leur intégration dans le système conventionnel ». Je suis co-auteur de plusieurs articles scientifiques (ethnoécologie) sur les savoirs endogènes et les sites naturels sacrés en Casamance et au Saloum.

M. Niang est Directeur Exécutif de JVE Sénégal et coordonnateur national de la plateforme Dakclim. Diplômé en énergies renouvelables, il est engagé pour le climat, la biodiversité et les emplois verts. Cofondateur de la Green Team Sénégal, il a lancé l'incubateur SEN GREEN LABS. Lauréat de plusieurs prix, il œuvre pour une transition écologique inclusive au Sénégal.

Agent technique de développement, M. Omer DIEDHIOU est un acteur majeur du développement communautaire, fort d'un riche parcours au sein de nombreuses structures. De 1986 à 2000, il a successivement occupé les fonctions de Secrétaire exécutif, Président, puis Chargé de la formation de l'AJAEDO (Association des Jeunes Agriculteurs et Éleveurs du Département d'Oussouye). Parallèlement, il a été coordinateur africain des jeunesses agricoles catholiques et membre actif de leur coordination mondiale.
Entre 2006 et 2015, il a collaboré avec le GRDR, Child Fund et Caritas Ziguinchor. Dans ce cadre, en partenariat avec la communauté de Mlomp, il a mis en place l'Aire du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) Kapac Olal, qu'il a dirigée jusqu'à son intégration à l'Aire Marine Protégée en 2022. De 2015 à 2024, il a rejoint le Conseil Départemental d'Oussouye en tant que Responsable de la Division Environnement et Développement Durable, Chargé de Projets. Actuellement, M. Omer DIEDHIOU préside le Comité de gestion de l'Aire Marine Protégée Ufoyaal Kassa Bandial ainsi que la Plateforme Mangrove Casamance, contribuant activement à la préservation des écosystèmes et au développement durable en Casamance.

Mariama Thiaré, née en 1968 à Niodior dans le Delta du Saloum (Sénégal), s'installe à Bambougar El Hadji après ses études à Dakar. Employée dans l'hôtellerie, elle s'engage parallèlement comme enseignante bénévole pour lutter contre l'analphabétisme, réussissant à mobiliser des fonds pour construire une école et obtenir du personnel. En 2002, elle fonde le GIE Rogga Fakha, qui regroupe aujourd'hui 68 femmes autour d'activités telles que l'agriculture, la pêche, l'apiculture et la transformation, assurant ainsi leurs revenus. En 2022, elle entre en politique et devient Adjointe au Maire de Diossong.
Elle est également Présidente du Réseau des femmes de la Commune, du Collège National des transformateurs de la mangue et de la Fédération FAGIR Saloum. Son parcours témoigne d'un engagement fort pour l'éducation, l'autonomisation des femmes et la gestion durable des ressources locales.